Un poète des petites rencontres de la vie quotidienne
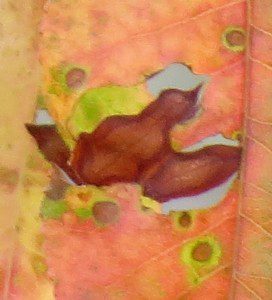 Le journal montréalais La Patrie du 27 juin 1906 nous annonce le décès par suicide du poète, journaliste et écrivain Charles Frémine (1841-1906). Le pauvre homme, habitant depuis longtemps rue d’Assas à Paris, souffrait d’un cancer et avait décidé de mettre un terme à ses jours.
Le journal montréalais La Patrie du 27 juin 1906 nous annonce le décès par suicide du poète, journaliste et écrivain Charles Frémine (1841-1906). Le pauvre homme, habitant depuis longtemps rue d’Assas à Paris, souffrait d’un cancer et avait décidé de mettre un terme à ses jours.
Dans ses dernières volontés qu’il avait, quelques jours auparavant, dictées à une amie, le malheureux poète demandait que son corps soit incinéré; que son frère Aristide, mort en 1897, fût exhumé et incinéré à son tour, et que leurs cendres, confondues dans la même urne, fussent déposées dans le caveau de famille qu’ils possèdent dans la Manche, à Bricquebec, leur ville natale, avec cette inscription au-dessous de leurs noms : «Ils ont aimé et chanté leur pays».
J’aime beaucoup Paris pour y être allé quand même à plusieurs reprises. Et ce Frémine prenait plaisir à chanter le quotidien, non seulement dans son pays d’origine, en Basse-Normandie, mais également à Paris. Et, par bonheur, la Bibliothèque nationale de France a mis en ligne sur Gallica l’ouvrage Promenades et rencontres, de Frémine, publié en 1905. Succession de petits tableaux, une formule que j’apprécie.
Ici, il nous apprend que certains vendent des moineaux peints.
Par ces premiers jours de renouveau, où la campagne est encore frileuse, j’aime m’en aller à l’aventure à travers mon vieux Paris, remonter ou descendre l’ancienne rue sinueuse, profonde, embrumée, avec ses hautes maisons bombant du ventre ou rejetées en arrière, superposant étages sur étages, échafaudant encore sur leurs toits cent constructions bizarres, amusantes, dans un pêle-mêle de tuyaux, de girouettes, de cheminées noircies; la rue pleine d’imprévu, où l’on flâne, où l’œil déniche presque à chaque pas une curiosité, un morceau d’art, un souvenir : l’auvent sur une inscription latine, le mascaron usé d’une fontaine, le marteau de fer forgé ouvragé d’une vieille porte cochère; la rue noire de peuple, joyeuse, familière, où chantent les cages et les métiers, et où parfois débouche et s’arrête dans un coup de soleil une charrette à bras toute chargée de fleurs du printemps.
Quel éblouissement et quelle fraîcheur ! Des tas de violettes, des narcisses blancs, des coucous jaunes, des jacinthes, des anémones, des giroflées avec une bordure de mimosas retombant en panaches d’or : «Fleurissez-vous, mesdames ! Fleurissez-vous !»
Et la modiste qui passe, son carton à la main, flaire de son petit nez retroussé cette charretée de parfums et pique, en riant, à son corsage un bouquet bleu de deux sous.
C’est ainsi que, tout en musant, j’arrivai sur le boulevard Richard-Lenoir, dans le quartier Saint-Antoine. C’était jour de marché. Et comme j’ai toujours été très curieux des oiseaux, je me suis arrêté devant une cage pleine de bouvreuils et de chardonnerets, derrière laquelle se tenait assise une vieille femme, à l’œil exercé, l’oiselière.
— Vous ne m’achetez rien ? me dit-elle.
— Non; je ne suis pas du quartier, je passe; mais ils sont très jolis, très frais vos oiseaux; je reviendrai vous voir. Vous êtes là tous les jours de marché ?
— Oui, mais me reconnaîtrez-vous ? Je ne suis pas seule à vendre des oiseaux. Les miens au moins sont naturels. Voyez plutôt ! ils ne déteignent pas.
— Comment ! fis-je; on vend donc des oiseaux peints ?
— Montez seulement plus haut, en tirant vers la Bastille, vous en trouverez de toutes les couleurs.
Plus haut, en effet, une volière m’attira par son étrange bigarrure. Onques ne vis volatiles pareils à ceux qu’elle renfermait. L’artiste qui les peinturlura avait dû vider plusieurs palettes sur leur plumage. Ils en étaient comiques à force de badigeon. Il y en avait de mi-partie rouge et vert, jaune et noir, mouchetés d’or et de feu, avec des ailes d’émeraude et des queues de vermillon; et, comme j’étais prévenu, il me fut facile de reconnaître sous ce bizarre coloriage de malheureux moineaux qui se regardaient avec méfiance, tout honteux d’être ainsi déguisés.
Je savais qu’on faisait des roses et des dahlias avec des carottes et des navets; j’ignorais qu’on fit des oiseaux du tropique avec des pierrots !

Tout comme Charles Frémine, son ami Charles Canivet (l’auteur des Colonies Perdues) était natif de Normandie mais journaliste à Paris
Celui-ci conte ainsi une de leurs parties de pêche dans leur pays d’enfance.
Malheureusement, l’article était prémonitoire sur la raréfaction des truites dans les rivières normandes.
Bonne lecture et bon appétit !
UNE PÊCHE A LA TRUITE
(1896)
Parmi les poissons de rivière, généralement insignifiants, sans saveur et sans goût, un seul ou à peu près fait exception : la truite. Délicat, savoureux, le transport lointain lui tait perdre toutes ses qualités; mais, cuit aussitôt péché, il ne le cède à aucun des meilleurs poissons de mer. Je ne parle pas de ces énormes truites des lacs qui apparaissent sur les tables parisiennes, au moment des grands dîners, zébrées comme des tigres, la chair rose, grasse comme celle du saumon, et qui se mangent à tant de sauces différentes et variées : non ! La truite qui m’occupe est la truite de rivière, de dimensions beaucoup moins grandes, mais si jolie et si brillante, si diaprée même, avec ses petites taches rondes bleues et roses quand elle s’agite, comme une folle, au bout de la ligne d’un pêcheur adroit. Car il faut une adresse sans pareille pour surprendre le poisson agile,soupçonneux, mais qui, comme la plupart des poissons. ne résiste point aux séductions de l’appât.
Les praticiens, qui s’y connaissent, — je ne parle pas des braconniers qui pillent les cours d’eau et les auront bientôt dépeuplés, si l’on n’y prend garde, — pêchent à la mouche, ou bien au ver, suivant la saison. La truite, affamée, ce qui est le propre de tous les poissons, animaux de digestion rapide, peut se jeter sur la mouche artificielle et se faire prendre; mais, comme appât, rien ne vaut le criquet, saisi à la pointe des herbes, qu’on enfile tout vivant et tout frais à l’hameçon et qui séduit la truite précisément parce qu’elle n’a pas savouré la bestiole depuis longtemps. Le ver, également appât de qualité, s’utilise principalement quand l’eau de la rivière est troublée, jaunie par de longues pluies d’orage, qui suppriment toute transparence, toute limpidité, et laissent le pulsion à la merci de sa gourmandise insatiable.
Autrefois, quand il y avait des moulins, le long des rivières, et par conséquent des chutes d’eau, les truites se jouaient dans l’écume, où il était possible de les entrevoir, au gré de la lumière, et de les amorcer précisément avec ces criquets dont elles sont si friandes, et sur lesquels elles se jettent, avec une volonté inouïe. Aujourd’hui, les moulins des meuniers sont disparus, sinon effondrés. Le joyeux bruit des roues, celui du blutoir, ne se font pas entendre. La progrès a tué cela, et il a tué aussi la pêche. Dans quelques années, si l’on persiste à laisser faire, la truite deviendra légendaire, et les honnêtes pêcheurs se demanderont ce qu’elle est devenue : les pêcheurs malhonnêtes, autrement dire les braconniers, l’auront anéantie, avec la complicité, ne l’oublions pas, de tant de protestataires qui s’adressent à eux, cependant, lorsqu’ils ont besoin de poissons de choix. La gourmandise est la complice la plus efficace du braconnage. Combien de magistrats correctionnels et de juges de paix n’écoutent pas la voix de la justice, quand ils ont à traiter des collègues et des amis ! Grâce à tout cela, à ces pillages de plus en plus audacieux et à ces inexplicables tolérances, les rivières se vident; et lorsqu’elles seront vidées réellement, les individus qui les exploitent et les pillent, n’ayant plus rien à faire, deviendront nécessairement voleurs, n’ayant jamais appris autre chose.
Quelle jolie pêche, cependant, que cette pêche à la truite de rivière, pour un homme adroit, ou pour un spectateur. En ce qui me concerne, je ne fus jamais que cela. Pour saisir les criquets sautillant d’une herbe à l’autre, c’était mon affaire, et le pêcheur que accompagnais ne manquait jamais d’appâts. Sérieusement, je l’admirais, dans l’exercice de ses fonctions, — car c’était une fonction qu’il exerçait, silencieux, attentif, se tenant assez loin de la berge, pour ne pas être vu du poisson qu’il convoitait, et traînant sur l’eau, au bout de sa ligne, avec de petits frémissements, le criquet tentateur.
De temps en temps, dans la chaleur silencieuse de la journée estivale, on entendait un bruit, comme quelque chose qui tomberait dans la rivière : c’était la truite qui sautait, autour de l’appât, hors de l’eau, comme pour se rendre compte. Enfin, sa gourmandise n’y résistant pas, elle happait; le pêcheur, d’un tour de poignet adroit, quoique presque inappréciable, ferrait, et alors la truite lancée dans l’herbe de la prairie, se tortillant au bout de la ligne, donnait des coups de reins et des coups de queue, cherchant toujours à se rapprocher de la rivière qu’elle devinait, qu’elle sentait, qui la sollicitait et l’appelait.
Un matin d’août, sur les midi, mon vieil ami Charles Frémine, pêcheur émérite, en avait déjà glissé trois, et de taille, dans le panier qu’il portait en bandoulière. Il lui fallait la quatrième; il ne s’en irait pas sans cela ! Ça me dérangeait bien un peu, car j’avais l’estomac dans les talons, et l’auberge, distante de quelques centaines de mètres, au bord de la route départementale, me sollicitait plus que je ne puis dire.
Cinq minutes disait le pêcheur, cinq minutes seulement ! J’en guigne une superbe qui rôde autour du criquet. Deux livres au moins, mon vieux, et tu comprends…
Je comprenais que j’avais très faim, et pour tromper l’appétit, j’admirais le charmant paysage que j’ai vu tant de fois, et qui, dans cette belle journée chaude, rutilait sous les rayons d’un impitoyable soleil, les coteaux voisins boisés, avec, çà et là, des manoirs dont les tourelles émergeaient, au-dessus de la mer de verdure, et, à travers les prairies, la rivière sinueuse, glissant sans bruit à travers les roseaux, presque inerte elle-même, sous les rayons brûlants de cet énervant soleil d’été.
Ça y est, dit soudain Frémine, et je vis, au bout de son énorme ligne, décrivant presque une demi-circonférence, la truite argentée qu’il lança dans tes herbes et que bientôt nous saisîmes, non sans peine, car elle glissait entre nos mains, l’un après l’autre, cherchant toujours à se rapprocher de la rivière, les yeux effarés, les lèvres écartées et les ouïes écarlates agitées de mouvements convulsifs, en proie aux premières atteintes de l’asphyxie.
Elle alla rejoindre les premières victimes, dans le panier d’osier. Nous couvrîmes d’herbes fraîches cette admirable pêche.
Et maintenant, allons déjeuner, dis-je, il n’est que temps.
Nous gagnâmes l’auberge, et, une fois arrivés, nous nous mîmes à la cuisine, une cuisine que je recommande aux gourmets, s’ils se trouvent jamais en pareille circonstance. Le poisson vidé, raclé, lavé à plusieurs eaux, on le jette à la casserole, non dans l’eau, mais dans le cidre pur, avec un bouquet de toutes les plantes parfumées des jardins, fraîches cueillies, et des oignons, et même de l’échalote. Les truites cuisent là-dedans, s’imprègnent du cidre et des aromates, et pendant qu’elles sont remuées par le liquide bouillonnant avec un bruit joyeux, du moins aux oreilles de gens affamés, en une petite casserole de terre cuite, fabriquée à Sauxemesnil où jadis les potiers possédaient des notions artistiques, on fait fondre du beurre, du bon et savoureux beurre normand, avec sel, poivre et une pointe de vinaigre; quand la mixture est réduite à l’état bien liquide, vite de la crème, jusqu’aux bords, tant que le vase en peut contenir, et, comme dit la Cuisinière bourgeoise : versez sur le poisson cuit et rangé dans le fond du plat, au milieu de bouquets de persil verdoyant! Quel festin ! Je garantis une chose, c’est qu’un plat de la sorte ne paraît jamais sur la table du président de la République lui-même.
Tout à coup, pendant que nous faisions honneur à la cuisine, nous entendîmes des cris d’angoisse, comme si quelque malheur venait d’arriver à la porte même de l’auberge; et l’aubergiste se précipita. les mains jointes au-dessus de la tête, dans l’attitude du plus parfait désespoir:
Ah ! mon Dieu ! Ah ! mon Dieu !
Eh bien. quoi, qu’est-ce qu’il y a ? Expliquez-vous.
Elle se laissa choir sur le banc même où nous étions assis, savourant les dernières bouchées de l’admirable pêche, la truite de deux livres ayant été réservée toutefois pour confondre les pécheurs prétentieux de la ville voisine.
Alors, nous nous levâmes et nous dirigeâmes vers la porte, histoire de voir de quoi il retournait et là nous fûmes aussitôt témoins d’un spectacle inoubliable. Les lignes ayant été déposées, en arrivant, contre la façade de la maison, appuyées par en haut sur la muraille, et par en bas maintenues par un petit mur à hauteur de ceinture, nous aperçûmes un pauvre petit poulet, gros à peine comme un poignet de jeune fille, hagard, l’hameçon dans le gosier, ses petits yeux effarés et n’osant faire un mouvement, tandis que, dans l’intérieur, l’aubergiste se répandait en lamentations :
Un poulet superbe, d’une race exceptionnelle, et que, dans quelques semaines, les amateurs auraient payé une pistole ! Ah ! mon Dieu !
L’immobilité de la victime et le désespoir de l’aubergiste composaient une petite scène si comique, que nous partîmes, à la fois, d’un grand éclat de rire, au moment même où le mari, revenant de la moisson, rentrait pour le repas.
Du premier coup, il se rendit compte, saisit le poulet, après avoir ouvert son couteau, une sorte de serpe recourbée, au bout d’un manche de bois rougeâtre où brillaient, comme de l’or, les clous de cuivre. Alors, il fit une entaille dans le cou de la bête, sortit l’hameçon encore muni de son criquet, coupa la ligne au-dessus du crin de Florence et rejeta le poulet sur le sol, où, chose curieuse, il se mit à courir sur ses deux petites pattes, comme si de rien n’était. Du coup les lamentations de la femme cessèrent, et le sourire aux lèvres:
Quand je vous disais, fit-elle, que c’est des bêtes comme on n’en voit plus.
Possible, reprit le chirurgien, mais il faudrait recoudre
Elle rattrapa le poulet qui se sauvait comme un beau diable, et, pendant que nous prenions le café, elle recousit, avec une aiguille et du fil, comme si elle avait recousu un bouton à la culotte de son mari. Et, quand l’opération fut terminée:
Tout de même, dit-elle, il y a des bêtes ensorcelées, et je ne vendrais plus celle-ci, quand on m’en offrirait vingt francs.
Quelque temps après, nous revînmes et demandâmes des nouvelles du poulet pris à la ligne, comme une truite. Il n’avait pas survécu à sa blessure. J’ai toujours pensé que l’aubergiste aurait cent fois mieux fait de ne pas la recoudre.
Merci beaucoup pour cette belle pièce d’archives.