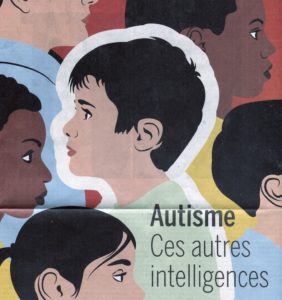Suis-je autiste ou neurotypique ?
Vous savez mon intérêt pour le cahier hebdomadaire — Sciences & médecine — du quotidien français Le Monde, édition du mercredi. Celui du 3 octobre 2018 contient un dossier sur l’autisme. Grand-père d’un petit-fils autiste léger, il me passe le miroir, me renvoie à moi-même.
Or, Γνῶθι σεαυτόν — connais-toi toi-même, aurait dit Socrate. Et il m’est donné d’observer de bien près mon comportement. Et manifestement, j’ai pour le moins certaines caractéristiques. Selon le dossier du Monde, nous sommes en train de raffiner un concept imaginé au début des années 1940.
Je préfère le retrait, le silence, le calme, loin de la société. La solitude ne m’effraie pas. Je n’ai plus de télé depuis bientôt deux ans. Mes intérêts se focalisent bien davantage sur les détails de mon environnement plutôt que les signaux sociaux. Je vis beaucoup moins dans le monde neurotypique que j’y ai vécu. Et, pour tout dire, je travaille à pouvoir publier en 2019 un ouvrage d’observations de comportements des vivants dans ma retraite lointaine hors de la ville.
Le professeur Laurent Mottron, psychiatre-chercheur à l’université de Montréal, et Simon Baron-Cohen, chercheur britannique, ont été parmi les premiers, selon la journaliste Florence Rosier, à montrer la puissance du cerveau autistique. Et cela notamment, dans un article retentissant publié en 2011 dans Nature. Le psychiatre français David Gourion résume une partie du contenu de cet article : « Le cerveau autistique surpasse le cerveau neurotypique dans toutes les tâches d’observation et de mémorisation de l’environnement, avec tous ses détails. Mais aussi dans les capacités d’abstraction qui lui permettent de modéliser cet environnement ».
Dans le cerveau des autistes, écrit Rosier, l’imagerie a révélé une hyperconnectivité entre les neurones. Cette particularité expliquerait leur pensée systématique, leurs bien meilleures capacités visuelles et spatiales et leur hypersensorialité. Le cerveau autistique intègre simultanément tous les détails sensoriels, il les mémorise d’une façon extrêmement précise et durable.
Selon le psychiatre Gourion, il est passionnant de suivre les modes de fonctionnement du cerveau d’un autiste, mais vient un temps où ce dernier a besoin de repos. Le cerveau autistique intègre simultanément tous les détails sensoriels, il les mémorise d’une façon extrêmement précise et durable. Mais cette puissance d’observation se paie d’une grande fatigue cognitive et d’un grand stress, le cerveau étant saturé de bruits, de stimuli visuels et sociaux : les autistes vivent dans un monde bien plus intense que le nôtre… Et cette capacité s’exercerait au détriment des compétences sociales. Par contraste, un cerveau neurotypique gomme toute une masse d’informations pour ne retenir que celles qui sont socialement pertinentes. […] Si Galilée, Darwin, Spinoza, Pasteur, Einstein et tant d’autres avaient été de grands mondains écumant les afters au petit matin après avoir dansé toutes les nuits comme des endiablés, nous en serions encore à gratter les silex sous la pluie…
Kamila et Henry Markram, de l’École polytechnique fédérale de Lausanne, ont proposé en 2007 la théorie du « monde intense ». « Il y a ceux qui disent que les personnes autistes n’ont pas assez de ressentis. Nous disons exactement le contraire : ils ressentent beaucoup trop […] Mais le monde est bien trop intense, donc ils doivent se retirer. »
Quand la journaliste Rosier demande à Gourion si l’extension du spectre autistique vers des formes légères est consensuelle, ce dernier répond ;
La question est très polémique. Cette vision élargie de l’autisme — aux frontières floues, il est vrai — rejoint celle d’un chercheur de renommée mondiale, Simon Baron-Cohen. Depuis les années 2000, il défend l’idée d’un continuum entre autisme et fonctionnement cognitif dans la norme («neurotypie»). Ce qui amène au concept de « neurodiversité » : une vision optimiste de l’autisme, qui met en avant ses forces particulières plutôt que ses déficits. Un notion méconnue en France, où l’on reste dans une vision pessimiste, réductrice de l’autisme, uniquement perçu comme un handicap. Des pays comme le Canada, la Suède ou le Royaume-Uni sont bien plus en avance que nous.
Florence Rosier, « Autisme, Ces autres intelligences », Paris, Le Monde, édition du 3 octobre 2018, cahier Sciences & médecine, p. 1, 4-5.
À paraître au Québec à la fin du mois d’octobre, l’ouvrage de David Gourion et Séverine Leduc, Éloge des intelligences atypiques, Éditions Odile Jacob, 2018, 292 pages.