Les petits métiers de la rue à Montréal (dernier de trois billets)
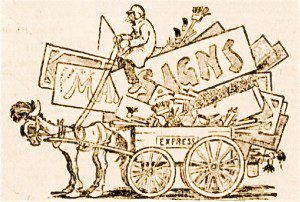 Avant-hier, on s’arrêtait à la vie des camelots à Montréal au début du 20e siècle. Hier, on parlait surtout des musiciens de la rue, toujours à Montréal. Aujourd’hui, nous nous échappons pour retrouver les métiers de la rue à Paris et à Londres.
Avant-hier, on s’arrêtait à la vie des camelots à Montréal au début du 20e siècle. Hier, on parlait surtout des musiciens de la rue, toujours à Montréal. Aujourd’hui, nous nous échappons pour retrouver les métiers de la rue à Paris et à Londres.
Les chiffonniers qui forment, à Paris, une importante corporation sont presqu’inconnus à Montréal. À peine en connaît-on une demi-douzaine qui, quand le temps est beau, vont faire dans le tas d’ordures un judicieux triage.
À Paris, le chiffonnier ramasse à peu près tout ce qu’il trouve : bouts de papier, pelures d’orange, vieilles chaussures, os, boîte de fer-blanc. Car tout cela se vend :
«Rien ne se perd dans la nature».
Il y a aussi, à Paris, les ramasseurs de «mégots», ou bouts de cigares et de cigarettes. Ces restes, convertis en tabac haché, se vendent aux amateurs, sur la place Maubert, deux fois par semaine, à 3 heures du matin. C’est le «Marché des Pattes Mouillées».
Une autre profession qui n’est guère exercée qu’à Paris est celle d’«ange gardien». Un ange gardien est une personne qui, attachée à l’établissement de quelque mastroquet, est chargée de veiller sur les ivrognes. Elle les accompagne à leur domicile, les protégeant, en cas de besoin, contre les malfaiteurs. L’ange gardien gagne une cinquantaine de sous par jour, mais il est souvent récompensé par les clients dont il a eu soin.
Dans certaines parties de l’Angleterre, des hommes font métier de couper la queue des chiens avec leurs dents. On s’imagine, là-bas, qu’un chien dont la queue a été coupée à l’aide d’un instrument — couteau ou ciseaux — perd ses qualités combattives.
À Londres, des individus achètent de la viande gâtée, la rajeunissent à l’aide de grattage et de lavage au permanganate de potasse, puis la revendent comme viande de première qualité.
D’autres, employés par des marchands de chaussures, sont chargés d’assouplir les bottes et les souliers des clients riches aux pieds sensibles. Ces singuliers travailleurs sont obligés de marcher une douzaine d’heures par jour, ce qui, après tout, doit être aussi fatigant que l’ouvrage des manufactures et des ateliers.
Mais, «des goûts et des couleurs, comme on dit, il ne faut pas disputer».
La Patrie (Montréal), 18 février 1905.
