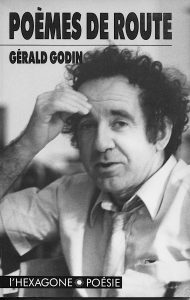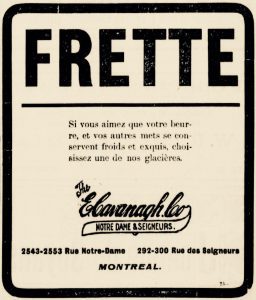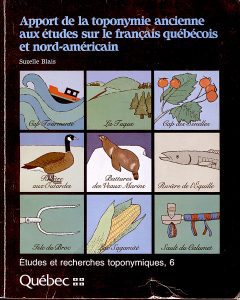Du grand Whitman
Au 19e siècle, aux États-Unis, des auteurs, du grand monde — Emily Dickinson, Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau et Walt Whitman — ont trouvé leur salut, dirais-je, dans la simple fréquentation de la nature et nous ont laissé des œuvres fort importantes.
Whitman est peut-être moins connu au Québec. Mais Rosaire Dion-Lévesque, lui, né à Nashua au New Hampshire, l’aime beaucoup. Lire la suite