Améliorons le français québécois
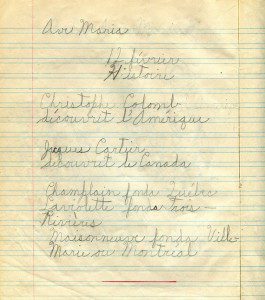 À la fin du 19e siècle et au début du 20e, des enseignants français viennent à Montréal pour quelques semaines prononcer des conférences publiques, en particulier sur les grands de la littérature de là-bas. Le 5 avril, nous rappelions sur ce site le passage de René Doumic qui entretenait l’auditoire de Lamartine.
À la fin du 19e siècle et au début du 20e, des enseignants français viennent à Montréal pour quelques semaines prononcer des conférences publiques, en particulier sur les grands de la littérature de là-bas. Le 5 avril, nous rappelions sur ce site le passage de René Doumic qui entretenait l’auditoire de Lamartine.
Un habitué de ces rencontres, semble-t-il, Philéas Beaudry, du 733, rue Sherbrooke, lance un cri d’alarme sur la qualité du français québécois. La Patrie reproduit sa lettre le 2 avril 1902.
C’est au lendemain d’une conférence comme nous en a servie M. Mabilleau que nous sommes solidement fixés sur la valeur de notre français à nous, comparé au beau langage de France. C’est à l’audition d’une telle parole que diverses erreurs à ce sujet sont bien flétries. Plus que jamais, toute discussion là-dessus devient oiseuse. Qu’on le veuille ou non, il nous faut admettre qu’en général dans nos salons, dans nos rues, dans nos affaires, dans nos arts, notre industrie, nos clubs, presque partout enfin, le français que nous entendons n’est que de l’iroquois à côté du français si suave de Paris.
Il y a trois, quatre ou cinq ans, c’étaient un Herbette, un Doumic, un Brunetière que la France nous envoyait. L’année passée, c’était un Deschamps; la semaine dernière, c’était un d’Estournelles; hier, c’était un Mabilleau, un Le Roux. Soyons heureux d’un mouvement si désirable. Recevons avec enthousiasme ces maîtres, fêtons-les avec cordialité, honorons-les dignement, pressons-nous en foule autour de leur tribune.
L’instruction pourtant, jetée partout avec profusion, améliorée sans cesse, voilà bien la vigueur première d’un nation. Elle doit occuper au plus haut degré la sollicitude de tout gouvernement. […] Un autre curatif d’une importance capitale pour notre français, et qui, lui, ne coûterait rien au gouvernement, serait d’exiger que les candidats à l’enseignement eussent la vraie prononciation française, et fussent questionnés sur une longue série de nos barbarismes et de nos solécismes les plus fréquents, et de même exiger par la voie de nos inspecteurs d’écoles, que cette prononciation se généralisât, que ces solécismes et ces barbarismes reçussent une attention spéciale, et aussi que l’enseignement de notre langue se fit plus pratique qu’il ne l’est maintenant.
Il est beaucoup trop théorique en effet, et pas assez pratique. Ainsi, nos jeunes garçons et nos jeunes filles sont légion, qui, après des années d’étude, ne peuvent s’exprimer convenablement sur les sujets les plus simples et les plus journaliers, comme nos tables, nos demeures, nos toilettes. De même, le moindre billet d ‘invitation, la moindre lettre de nouvelles, écrits avec pureté, naturel et élégance, leur est complètement impossible. Ce qui leur va mieux, c’est de s’empêtrer avec une triste apparence de succès dans une description du rêve, tel qu’un lever de soleil à la Châteaubriand.
Une telle réforme dans nos écoles du gouvernement se répèterait nécessairement dans nos écoles indépendantes, dans nos couvents, dans nos collèges, où, là aussi, les mêmes maux sévissent, et d’une façon d’autant plus regrettable que là, si on le voulait, la guérison s’effectuerait seule, pour ainsi dire, attendu que plusieurs des personnes qui y enseignent sont vraiment françaises et parlent leur langue à la perfection. Mais elles s’arrêtent à la bien parler et la laissent baragouiner par leurs élèves.
Un échantillon remarquable. Une fillette de quinze ans, dont sept de classe dans un de nos bons pensionnats, écrivait, sur la demande de sa mère, durant ses vacances dernières, le récit d’un goûter pris avec une amie, sur notre montagne. Voici : « Par un soleil radieux et par une brise superbe, nous partons Annette et moi, nous embarquons dans les chars de la rue St-Denis et nous demandons un transfert pour l’Avenue Mont Royal; nous sommes à la Montagne à trois heures, sous un arbre superbe, au feuillage ravissant. Après avoir ôté nos gants, nous avons développé notre goûter qui était platoniquement frugal, c’est-à-dire du fromage et des beurrées de confiture; après l’avoir pris, nous marchons quelques minutes, foulant une herbe fine et tendre, émaillée de quelques fleurs à l’odorat de pleine nature, et nous nous assisons pour jouer au Cousineau, un jeu que moi et Annette aiment bien. J’ai gagné 2 parties, j’en ai perdu une, faute à Annette qui a fait misdile et m’a ôté une souipe. Nous sommes chez nous à quatre heures, gardant une réminiscence grandiose de cette journée. »
Que dire de ça ? … Est-ce assez laid ?…
Ah, la langue française, si souple, si vibrante, si belle, ne la méconnaissons pas ainsi, ne l’injurons pas à ce point ! Chérissons-là, vénérons-la, cultivons-la, avec un soin extrême, ne négligeons aucun curatif, unissons-nous tous dans un effort constant et enthousiaste pour lui donner ici toute la valeur et la suavité qu’elle a en France, dans la bouche des maîtres en littérature. Nous y puiserons une force immense pour acter notre avenir, qui doit être grand d’une grandeur qui participe de celle de nos frères de là-bas.
Philéas Beaudry
