Quelles idées un homme que j’admire pouvait avoir de la mort et de l’immortalité de l’âme à 33 ans, il y a de cela 146 ans ?
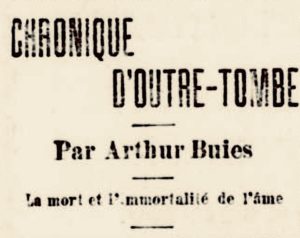 Arthur Buies meurt à l’âge de 61 ans, à Québec, le 26 janvier 1901.
Arthur Buies meurt à l’âge de 61 ans, à Québec, le 26 janvier 1901.
Quelques jours plus tard, le quotidien montréalais La Presse, pour lui rendre hommage, publie un long texte qu’il avait écrit à 33 ans. Il faut savoir que l’homme baigne dans une société cléricale, qui n’est plus la québécoise d’aujourd’hui. Extraits.
Être seul près d’un feu qui rayonne et pâlit tour-à-tour, par une de ces nuits d’hiver où les rafales du vent font crier les toits et gonflent les cheminées de bruits qui courent dans tous les sens ; quand l’ombre des arbres, luttant avec le froid et monotone éclat de la lune, s’étend sur la neige comme un crêpe sur un front de vierge, est-il rien dans la vie qui approche de cette jouissance que l’on concentre et que l’on réchauffe pour ainsi dire autour de soi ? Est-il une heure comparable pour la rêverie, les tranquilles retours vers les tourments du passé, la douce fréquentation de tant de fantômes chéris qui reprennent un instant leur forme réelle pour inonder l’âme avide de se retrouver et de se rajeunir par l’illusion ?
Veiller aussi tard qu’on le peut, étendre les longues soirées d’hiver jusque bien avant dans la nuit et se lever ensuite avec le jour, c’est un moyen de prolonger la vie, de fixer quelques minutes son éclair rapide. D’autres diront que c’est le plus sûr moyen de l’abréger ; ils se trompent. On vit double, on vit triple durant ces longues et cependant fugitives heures que l’on donne à la méditation, à la revue silencieuse des années envolées, au bienfaisant espoir de revivre plus tard dans un monde sans regrets et sans alarmes.
Pour échapper aux misères qui nous entourent, à la certitude désolante que tout est faux, périssable, qu’il n’est rien sur lequel on puisse fonder une assurance absolue, sans faire une large part aux défaillances humaines et à l’égoïsme d’autrui qui est l’écueil de toute confiance, il n’y a qu’un remède, se plonger dans l’idéal et créer par la pensée une existence en dehors de toutes les atteintes.
Lorsque je m’abandonne ainsi à cette divinité familière qu’on appelle la réflexion et qui m’attend toujours, patiente comme une veilleuse, dans quelque coin de ma chambre solitaire, il est une chose qui me frappe souvent, c’est l’impossibilité de la mort. Pourquoi la même pensée me revient-elle toujours, sous une forme presque réelle, comme un ami qui me parle pour me rassurer ? je ne l’explique pas, si ce n’est que rien ne peut me contenter de ce que je vois, de ce que j’ai et de ce qui me charme un jour pour me laisser le lendemain le dégoût ou le regret.
La mort, comme toutes les choses de ce monde, est relative. On est dissous, on est disséminé, pulvérisé, mais on reste quelque chose. Il n’y a pas une petite partie de cadavre qui ne se trouve un jour, sous une forme ou sous une autre, mêlée à d’autres objets. Être quelque chose indéfiniment, toujours, faire partie d’une multitude d’existences futures qui, leur tour, se transformeront, se mêleront, voilà pour le corps. Quant à l’âme, qui est entièrement séparée de son enveloppe, quoi qu’on en dise, elle reste immortelle, invariable, dans son essence. Elle embellit, se spiritualise, se purifie de plus en plus, mais ne change pas. […]
La Presse (Montréal), 2 février 1901.
