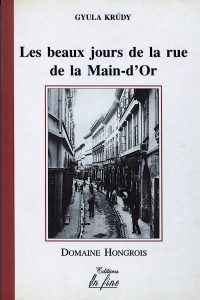Retrouvons-nous en Hongrie, humble pays à la grande civilisation, en particulier aux écrivains remarquables
Gyula Krûdy (1878-1933) est l’un de ceux-là. L’historien de la littérature hongroise, György Tverdota, qui enseigne à l’université de Miskolc, une ville très ancienne, à l’occupation humaine depuis 70 000 ans, affirme qu’au tournant du 20e siècle, alors que les écrivains hongrois ont le devoir de traiter de problèmes nationaux ou sociaux, « de situer explicitement leurs personnages dans une situation sociale, de souligner leur rôle dans la cité », Krûdy, lui, fait route à part.
Il choisit « de puiser dans son expérience personnelle des relations entre les hommes et les femmes, de raconter des histoires d’amour qu’il tirait de son imagination ».
Selon Tverdota, Krüdy s’attache à décrire le halo érotico-culturel qui entoure l’amour : « le flirt, la galanterie, la séduction, les gages d’amour, la fidélité, la jalousie, les cadeaux, les rivalités, les superstitions, les manœuvres de conquête de l’homme auxquelles répondent les stratégies de défense de la femme, les fétiches, les conventions, les complications de la communication amoureuse ».
Nous sommes à Budapest. Extraits de la nouvelle « L’oie sauvage », du recueil de Gyula Krûdy, Les beaux jours de la rue de la Main-d’Or.
Les oies sauvages volaient la nuit au-dessus du Danube et leurs cris descendaient des hauteurs vers la terre, comme si des âmes errantes de passage près de Budapest s’enquéraient les une auprès des autres des curiosités de la ville. […]
Une porte s’ouvrit sur un balcon et dans la nuit, comme un rêve immaculé, se montra une silhouette de femme.
Le galant qui regardait les oies sauvages, un certain Pankotai, achevait son habituel vagabondage nocturne. Il, eût aimé savoir ce qui se passait derrière la fenêtre aux rideaux tirés, il observait l’apparition nocturne le cœur battant. Il s’imaginait, projetait, rêvait toujours qu’une nuit, une fenêtre s’ouvrirait et qu’une main blanche laisserait choir une fleur à ses pieds, comme devant un mousquetaire errant sans but dans le vieux Paris, ou à Madrid, la ville des balcons fermés et des fenêtres à barreaux…
Le quai était désert, au loin roulait une voiture, comme un remords qui somnole doucement, une dame en robe blanche se tenait au premier étage, Pankotai lui souhaita le bonsoir à haute et intelligible voix et se redressa dans la pénombre.
— C’est un homme malheureux qui vous supplie de lui faire l’aumône d’une parole.
Naturellement, elle ne répondit pas […]
— Un seul mot, madame, et vous sauverez la vie d’un homme condamné à mort. Je vous aime.
Le mensonge inattendu faisait presque toujours mouche chez les femmes ; elle sortit une fleur blanche de ses cheveux et d’un geste ample et généreux, la laissa choir. Puis, elle se retira et la porte se referma derrière elle dans un lent grincement. Pankotai huma et regarda longuement la fleur sous le lampadaire au coin de la rue. C’était une fleur d’oranger et il s’imagina mille possibilités liées à ce présent. […]
(…) le nuit suivante, il se posta à nouveau sous le balcon avec assurance, comme si c’était l’endroit où, depuis des années, il aimait désespérément des rideaux blancs.
Dans la nuit d’automne, les oies sauvages criaillaient de nouveau au-dessus du Danube dont le cours les guidait à l’aller et au retour, coua-coua, résonnait le cri des grands oiseaux mystérieux qui passent une grande partie de leur vie en migrations, allant et venant du nord vers le sud, comme si le but de leur vie était de connaître les vents qui soufflent dans les hauteurs, de contempler les flots et de ramasser la poussière d’étoile entre leurs plumes pour l’emporter vers d’autres contrées où resplendissent d’autres étoiles, du sud ou bien du nord… Pankotai se mit à faire des signes avec son chapeau vers les cris qui venaient du ciel.
— Taisez-vous, ne troublez pas le sommeil de la bien-aimée.
Mais la fenêtre du balcon s’ouvrait déjà, la dame qui s’était réveillée sortait dans sa robe blanche. Elle leva les yeux vers le gris de la voûte céleste et Pankotai la vit étendre les bras. […]
Elle se tenait immobile dans les hauteurs. Il sentit une manière de caresse délicate passer sur son visage, comme un baiser envoyé de l’au-delà. Une petite plume bouclée et duveteuse était tombée d’en haut, la plume tendre d’une oie sauvage, et la porte du balcon se referma doucement. […] Qui l’avait envoyée, la dame ou les oiseaux migrateurs ? […]
Pankotai passa encore quelque nuits sous le balcon de l’inconnue. Le rêve en robe blanche apparaissait toujours à minuit, quand le criaillement des oiseaux sauvages s’élevaient aux environs du pont Marguerite. La dame se mettait à son balcon et regardait avec envie vers le ciel, comme si son père ou son fiancé eussent voyagé dans la nuit avec les oies. Tant qu’elle entendait les cris mystérieux et fantastiques au firmament, elle restait sur son balcon, les bras en croix. On eût dit une oie sauvage ensorcelée au premier étage d’un immeuble de Budapest, dont le cœur se fendait au moment de la migration de ne pouvoir partir vers le midi avec ses frères et sœurs. […]
Mais une nuit, les cris vifs des oiseaux ne retentirent plus au-dessus du Danube.
Ils attendirent longtemps : lui sur le quai, elle sur son balcon… et ils perdaient déjà espoir quand, au loin, presque dans l’au-delà, s’éleva un unique cri d’adieu. La dernière oie quittait le ciel de Budapest. Le triste automne était irrémédiablement là.
Une feuille de papier tomba aux pieds de Pankotai. Les menues lettres disaient :
— Adieu.
La porte du balcon ne s’ouvrit plus la nuit et Pankotai occupa de plus en plus rarement son poste désormais inutile.
Des mois plus tard, sa passion et sa tristesse apaisées, il alla se renseigner dans l’immeuble sans même que sa voix tremblât : il apprit que la dame du balcon était une demoiselle poitrinaire qui n’avait pu se rendre en Égypte à cause de la guerre mondiale et qu’elle reposait désormais au cimetière.
Gyula Krûdy, Les beaux jours de la rue de la Main-d’Or, traduit du hongrois par Natalia Zaremba-Huzsvai et Charles Zaremba,Paris, Éditions In Fine, 1997, p. 60-65.
Titre original : Aranykéz utcai szép napok.
Merci, chère Melinda, de ce cadeau magnifique.