Toujours au Salon international du livre de Québec et la Tunisie
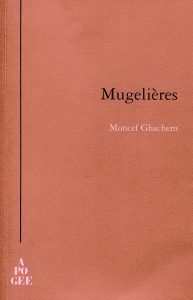 Avec Moncef Ghachem, on peut passer des heures à l’écouter tant le dépaysement est grand. Cet homme chaleureux habite près de Carthage à la si longue histoire. Soixante–dix ans. Il vient d’une famille rare en Tunisie, dit-il, celle de pêcheurs depuis quatre générations. Il a connu Aragon, traduit René Char et Guillevic, parle de Flaubert. Il nous entretient des divers accents des langues arabe et française. On le questionne et toujours il avance ses réponses avec douceur, quasi avec tendresse.
Avec Moncef Ghachem, on peut passer des heures à l’écouter tant le dépaysement est grand. Cet homme chaleureux habite près de Carthage à la si longue histoire. Soixante–dix ans. Il vient d’une famille rare en Tunisie, dit-il, celle de pêcheurs depuis quatre générations. Il a connu Aragon, traduit René Char et Guillevic, parle de Flaubert. Il nous entretient des divers accents des langues arabe et française. On le questionne et toujours il avance ses réponses avec douceur, quasi avec tendresse.
On quitte vraiment avec regret ce sage à la grande culture, en gardant l’espoir de le revoir. Il y a des personnes parfois qu’on croise où l’on se prend à regretter que la Terre soit si grande et la vie si courte que l’une ou l’autre ne nous permettra pas de les revoir.
Dans son livre Mugelières, Moncef [prénom commun, nous dit-il] nous raconte si bellement son lieu de naissance en bordure du cimetière marin de Mahdia.
Souvent, c’est sur la barque familiale que je m’en vais pêcher… Rameur à l’avant de l’équipage, tireur de senne ou ramasseur du cercle mortel, je guette l’orphie et son éclat sur le champ étale, ou bien je remonte à bord le filet à étroites mailles (filet-makrouf) rempli tout au long de ses flotteurs, de mulets dorés à corps lacté et à chair pleine…
Débroussaillée à la hâte, plus en bas des maisons riveraines, une piste serpente à travers le cimetière et mène jusqu’aux barques du vieux port. Esquifs amarrés à un récif ocre qui sert de quai aux pêcheurs de la cité, à peine un peu plus d’une trentaine d’hommes sans lesquels la mer ne serait que mutisme et mystère…
Descendant vers le vieux port où l’on a abrité les barques de l’espoir, ou alors revenant de la mer et entrant à la maison, une gerbe de dîner à la main, je traverse le cimetière. Ce sont ces tombes alignées en terre cendrées, tombes familières ou inconnues qui accueillent, les premières, mon récit de bonne prise ou d’infortuné voyage… Avec elles, je m’abandonne dans un langage d’allégresse et de conquête, ou au contraire, dans la rude parole d’une déception impossible à évacuer, à propos de cette mer de malchance, de misère et de stérilité…
À ces tombes de Mahdia, singulière citadelle de la mer où vinrent reprendre des forces de verve des poètes arabes médiévaux, puis des forces d’attaque des coriaces corsaires barbaresques, à mon tour, je raconte mes mésaventures de pêcheur dont l’ancre s’est accrochée dans une grotte inébranlable des profondeurs. Ou bien, j’égrène les grappes d’une fierté ancestrale car ma rame d’albâtre a caressé l’épaule des écumes et fait glisser la barque sous de fortes rafales jusqu’au vieux port Belleaa.
Quand s’annonce le printemps avec des explosions de marguerites jaunes et d’asphodèles, avec des naufrages d’arômes dans le blanc enflé des pierres tombales, le cimetière de Mahdia retrouve son gîte magique dans la profonde amphore antique. Il se laisse embrasser par la mer aux lèvres humectées d’étoiles et de sel. L’abeille vient alors butiner sur les fleurs jaunes de l’immémoriale terre. L’oiseau colibri ou le martinet se hâtent d’amasser brins d’herbes et tiges de paille, pour bâtir leurs nids. Jusqu’aux rivages arrivent les bancs frétillants que chassent à coup de museau tranchant l’espadon et le thon, le germon et la bonite. De nouveau peintes couleur havane et verte ou, moins souvent, blanche et rouge, les barques sont poussées sur l’échine bleutée des sables mouvants. Leurs poupes chargées de filets dérivants, elles s’en vont, s’enfonçant dans les eaux de l’espérance… Alors, en ce printemps venu couvrir de nattes et de tapis de fleurs le cimetière, la mémoire de Mahdia se réveille, limpide parole qui lie les morts aux vivants dans des bouquets de voix lumineuses et douces, ou chaotiques et brisées comme les vagues des équinoxes contre l’obscur récif.
Audible autant que visible, autour des tombes et sur les herbes qui les envahissent, la mémoire de la ville répand sa langue de contes et de récits insulaires, égrène son chapelet solaire de mots pauvres et nus. À la voix des vivants, s’allie et s’unit la voix ressuscitée des anciens résidents de la cité marine, pour ne plus former qu’une seule et même voix aux accents sereins et paisibles, bien que parfois éteints et affaiblis… Comme un grain semé pour une pluie fécondante et volubile, que ma voix devienne l’épi fertile de ma ville, qu’elle soit à la fois le chant et l’enfant de sa mémoire maritime !…
Et cet homme rencontré est tellement à la hauteur de ces mots !
Moncef Ghachem, Mugelières, Pêcheurs de Mahdia et de Salakta, Rennes, Éditions Apogée, 2010, p. 30-32.
La photographie de Moncef Ghachen, de Vincent Capman, apparaît sur le site de Paris Match.
La photographie du cimetière marin de Mahdia apparaît sur la page Wikipédia consacrée à cet homme bien attachant.
Et la dédicace donc, tellement généreuse !
La photographie au Salon du livre est de René Bouchard.
Salut, cher Moncef ! Avec l’espoir que nos vies se croisent à nouveau !





Bravo Jean. Tu as su capturer l’essence de Montcef Ghachem, magnifique poète qui transmute l’ordinaire des choses en récits épiques et qui nous entraîne avec lui dans la transhumance des âmes. Plus grand que nature par la hauteur de ses mots, mais près du cœur des gens par sa simplicité d’homme, il nous a tous impressionnés au dernier Salon international du livre de Québec. René
Merci, cher René, merci beaucoup. Je rentre à l’instant du salon.
Quelle belle personne que cet homme.
Ah oui, absolument : « Plus grand que nature par la hauteur de ses mots, mais près du cœur des gens par sa simplicité d’homme ».
Je l’écouterais parler du milieu d’où il vient, de ses parents, etc.
Et sa mère devait assurément cuisiner des plats de poisson fort délicieux, selon une ou des recettes remontant à des temps anciens.
Que j’aimerais encore m’attarder !