Qu’en est-il des Québécois installés en Nouvelle-Angleterre ?
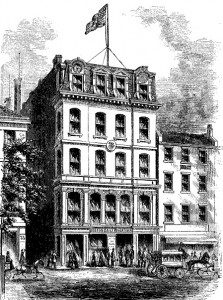 Un journal bostonnais, le Boston Advertiser, du 26 octobre 1881, parle des Québécois de langue française habitant maintenant le nord-est des États-Unis. Un document fort intéressant que reprend le quotidien de Québec, Le Canadien, quelques jours plus tard, le 5 novembre 1881. La traduction n’est manitestement pas une œuvre d’art, mais tout de même de l’information s’y glisse.
Un journal bostonnais, le Boston Advertiser, du 26 octobre 1881, parle des Québécois de langue française habitant maintenant le nord-est des États-Unis. Un document fort intéressant que reprend le quotidien de Québec, Le Canadien, quelques jours plus tard, le 5 novembre 1881. La traduction n’est manitestement pas une œuvre d’art, mais tout de même de l’information s’y glisse.
L’hon. M. Carroll D. Wright, chef du bureau des statistiques, a donné hier une audience dans l’hôtel du gouvernement de Massachussets aux représentants canadiens-français des États de la Nouvelle-Angleterre et de New-York, au sujet de la position des Canadiens français dans ces États.
D’après l’ordre de la législature de 1880, le bureau a fait une enquête dans les États du Maine, de New Hampshire, de Rhode Island, du Connecticut et de New-York, relativement à un système uniforme de lois pour régulariser les heures de travail dans les états mentionnés, et a soumis le résultat de cette enquête dans son douzième rapport annuel.
Dans ce rapport, le Bureau dit que la troisième objection à dix heures de travail est la présence des Canadiens français. Partout où ils se trouvent, on regarde leur présence comme un obstacle à réduire les heures de travail à dix. Il est difficile de préciser les raisons de cette manière d’agir.
À quelques exceptions près, les Canadiens français sont les Chinois des États de l’est. Ils ne s’occupent nullement de nos institutions civiles, politiques et scolaires. Ils ne viennent pas pour s’établir parmi nous, pour habiter avec nous comme citoyens et devenir ainsi partie de nous-mêmes; mais leur but est tout simplement de séjourner quelques années comme étrangers, nous ressemblant par un seul point : celui du travail. Et une fois qu’ils ont obtenu de nous ce qui peut satisfaire leurs désirs, ils retournent d’où ils reviennent et dépensent ce qu’ils ont gagné.
Ils sont une horde d’envahisseurs industriels et non un courant de colons stables. Il est rare que l’un d’eux se fasse naturaliser. Ils n’envoient point leurs enfants à l’école, s’ils peuvent faire autrement, mais ils s’efforcent des les entasser dans les manufactures dès l’âge le plus tendre
Les Canadiens français ont protesté contre ces remarques et ont exprimé leur mécontentement par plusieurs résolutions qui ont été envoyées à la législature l’hiver dernier. Ces résolutions ont été renvoyées au Bureau sans commentaires.
Afin d’obtenir les meilleures informations possibles et pour donner au peuple canadien-français l’occasion de se faire entendre, le colonel Wright a adressé un grand nombre de circulaires aux parties intéressées, les invitant hier à une entrevue avec lui. Près de cent personnes ont répondu. Sur ce nombre, on remarquait des journalistes, des membres du clergé canadien et des hommes de profession et d’affaires […].
Le premier témoin entendu a été M. F. Gagnon [sans doute Ferdinand Gagnon qui s’est beaucoup battu pour l’honneur des siens]. Il a dit que les Canadiens français ne s’étaient jamais opposés à une réduction des heures de travail et qu’on ne leur a jamais demandé une semblable réduction. D’après les statistiques, il est prouvé que, dans trente et une cités et villes, avec une population de 399,000 âmes, il y a 92,5000 Canadiens français, représentant environ 10,000 familles, et sur ce nombre de familles, 2,000 sont devenues propriétaires et ne sont pas les «Juifs errants» mentionnés dans le rapport.
Dans ces trente et une cités et villes, on compte 15,900 élèves canadiens-français sur 65,500 enfants fréquentant les écoles. D’autres témoins donnèrent des rapports détaillés sur différents districts. Ils démontrèrent que les Canadiens français sont sobres et industrieux, que leurs enfants fréquentent les écoles, que les églises et les écoles de paroisses et du soir se multiplient rapidement, et que la proportion des hommes qui ont été naturalisés et sont devenus propriétaires était considérable, si l’on fait attention que l’immigration n’est commencée que depuis un petit nombre d’année.
L’édifice du Boston Advertiser, vers 1872, provient de l’ouvrage d’Edward Stanwood, Boston Illustrated, publié par J. R. Osgood & co en 1872. On retrouve l’illustration sur la page Wikipédia en langue anglaise consacrée au quotidien bostonnais.
